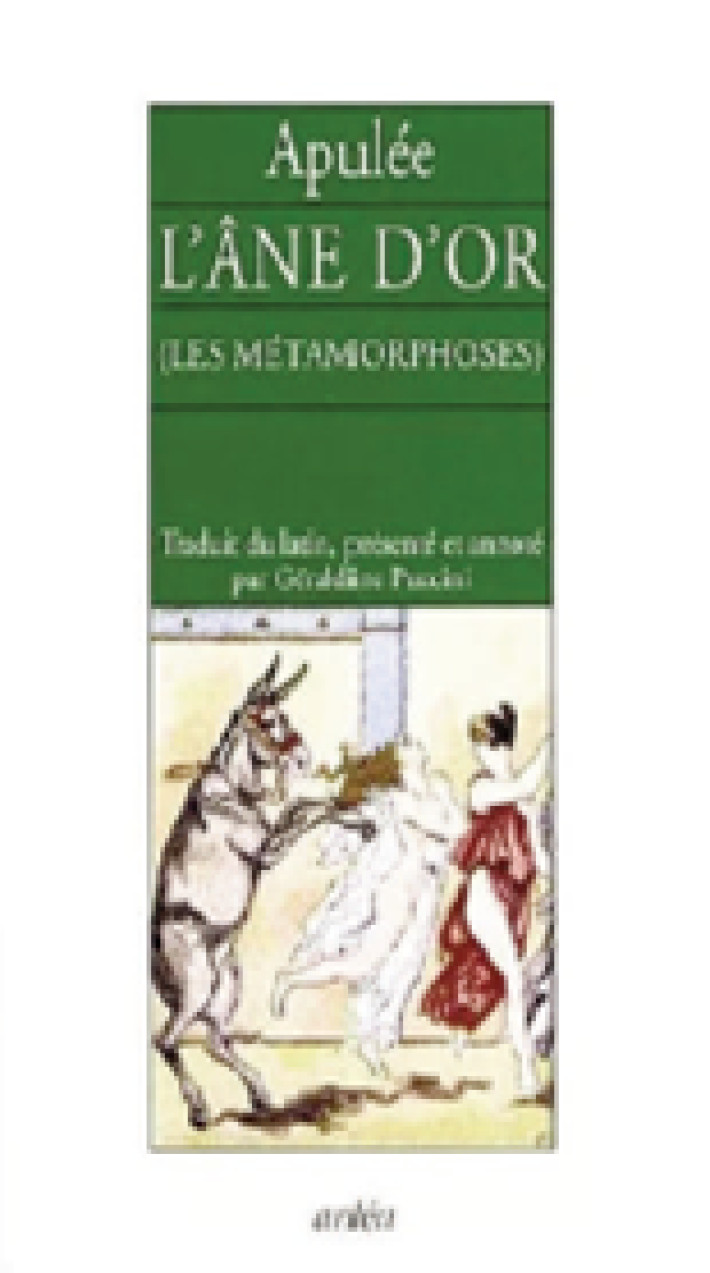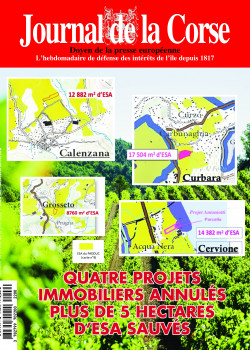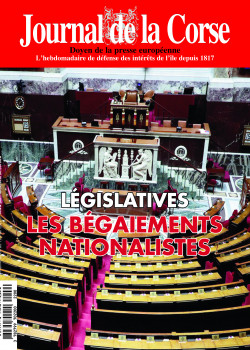Quelle est la conséquence de l'individuation socratique ?
La question mérite d'être posée avec clarté aujourd'hui alors que la société est submergée par des questionnements moraux qui la minent
Quelle est la conséquence de l'individuation socratique ?
La question mérite d'être posée avec clarté aujourd'hui alors que notre société est submergée par des questionnements moraux qui la minent, faute par elle de pouvoir en identifier sereinement les causes.
Quand on voit l'histrion principal du débat politique faire l'apologie du "grand remplacement" dont il avait commencé par nier l'existence au début du processus, avec sa tonitruesque et courroucée faconde, on comprend mieux l'urgence d'exposer au public l'enchainement des circonstances philosophiques et morales qui ont mené à la triste situation où se trouve le monde occidental.
N'oublions pas que cet univers développé et hautement civilisé, que l'on a commencé par identifier comme l'Europe et qui se confond aujourd'hui avec « l’occident » , est né en Grèce à l'époque de Pericles avant de se confondre avec le judaïsme à l'époque romaine, pour donner au monde l’éclosion du système de valeur « Judéo-chrétien". Ses racines sont hellènes et si le christ est mort sur la croix, comme le raconte sa légende , c'est parce qu'il est un homme, et pas parce qu'il est Dieu ! Elle est là la singularité qui fait du Christianisme un rameau de d'hellénisme socratique, c'est la présence du "daimòn" dans l'esprit humain, la conscience d'être "soi", et non la particule d'un « tout », qui différencie et oriente dès la mort de Socrate l'humanité éclairée vers l'éclosion et l'épanouissement de l’individu, du seul non pas opposé mais à coté du nombre.
C'est l'acte de divorce initial entre les dieux . Le Christianisme est avant tout hellène et son origine l’apparente, comme le judaïsme mais l’humanisant, au culte d'Isis et d’Osiris. C'est pourquoi nul fatum ne masque la conscience, mais au contraire l’aiguise. La morale héritée du Dieu du désert est de partager la charge de la souffrance humaine dans l'espoir de complaire à la hiérarchie issue de la prédestination, tandis que la société que prépare "l'occident" c'est l'aboutissement du destin humain, par l'éclosion du bonheur individuel.
Voilà le dilemme entre l'orient et l'occident. Partage du bonheur ou partage du malheur ?
Le schisme est là, constitutif, ancien, millénaire même. En Méditerranée se rejoue la bataille des Thermopyles. Nous connaissons l’avenir, c'est la guerre.
Plus que jamais il nous faut relire Jean Giraudoux, la Guerre de Troie n'aura pas lieu. Alors, Barnier, Bayrou,…..
L'aperçu que je viens d'évoquer laisse bien évidemment entières les confusions-alternatives sémantiques et historiques des notions utilisées. L'occident c'est l'ouest et l'orient l’est, donc ce qu'on appelle improprement l’orient, le monde arabo/musulman, se partageant entre le sud méditerranéen, le midi, et le continent asiatique, d'où les appellations souvent confondues de proche-orient et de moyen- orient, rien qu'à demi-mensongères. Cela est révélé par le fait qu'en langue arabe, Maghreb veut dire occident, jadis partie méridionale de la mare nostrum romaine. Notons au passage que Saint-Augustin est né à Constantine en Algérie d'aujourd'hui et Apulée, auteur du roman symbolique romain l'âne d’Or, à Madaure, également en Algérie.
Ceci précisé, afin ne pas confondre les énonciations modernes avec la vérité chronologique, la Grèce par exemple, citée comme le terreau de la pensée occidentale se situe à l'orient de L’Europe. C'est pourquoi je parle de la source européenne plus que du pôle occidental.
L'individuation est la matrice également de la pensée rationnelle, et donc à terme d'une certaine manière de voir le monde, par la création mentale qui fait de l'homme pensant le double d'un autre, absent et théorique. La démocratie vient de là, orné des habits de tous les régimes qui se sont succédés en Europe, car le christianisme inspirait par le souvenir répété du calvaire de Jesus, à la fois homme et Dieu, la prévalence spirituelle et morale de l'homme seul contre le nombre des autres.
Mon maître le sénateur Henri Caillavet avait l'habitude de finir ses discours en loge, au parlement ou dans tous les cénacles ouverts qui se disputaient l'honneur de quêter sa parole, par cette phrase emblématique : nous ne serons pas les assassins de Socrate.
Voilà qui est dit.
Jean-François Marchi
PHoto : J.F.Marchi