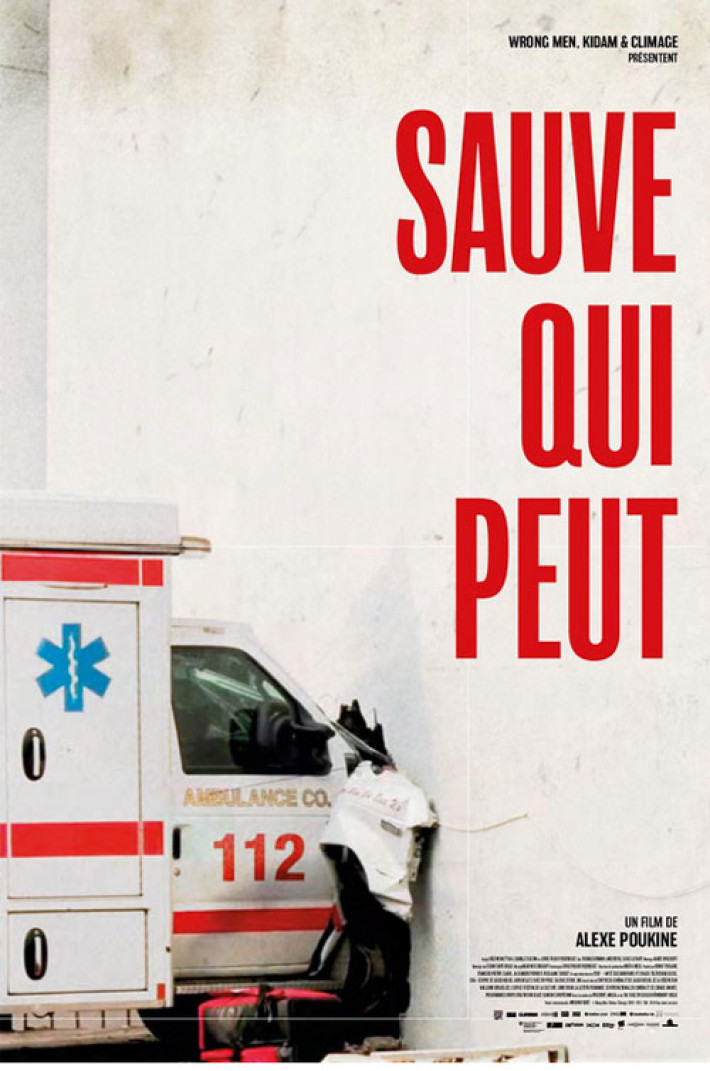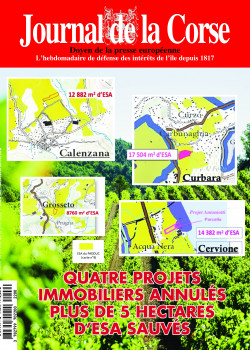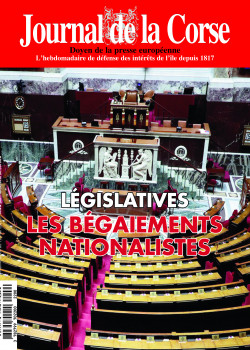Festival "Best of Doc", "Sauve qui peut" , film d'Alese Poukine
<< Sauve qui peut >> , film d'Alese Poukine
Festival « Best of Doc »
« Sauve qui peut », film d’Alexe Poukine
A quoi servent les exercices de simulation qui font désormais partie de l’enseignement des infirmières et de certain personnel médical ? Simulation à entendre dans le sens de « faire semblant » : une étudiante, par exemple, face à une consœur. Simuler signifie en l’occurrence « faire semblant » afin de prévenir avec délicatesse, doigté, son état à patient angoissé. Voilà ce que démontre Alexe Poukine dans son documentaire, « Sauve qui peut ». Un film projeté récemment à Bastia et à Ajaccio.
Finies normalement les annonces de tumeur maligne ou de cancer entre deux portes, voire au téléphone, par un thérapeute pressé ! Finis d’être sidérés par une nouvelle brutale qui laisse sans voix et immobile telle une statue de sel… L’empathie envers un malade ça s’apprend et la simulation est une aide précieuse pour trouver les mots, le ton justes.
Dans le film que la cinéaste a tourné à l’hôpital cantonale de Lausanne en Suisse il y a des séquences saisissantes qui montrent combien à ce stade l’annonce d’une maladie grave n’est pas évidente à formuler. Il y a le cas de cette femme à talons hauts qui n’en finit pas de s’agiter
Car ses oreilles subissent, d’après elle, un flot de sirènes insupportable. Décondensée au début par cette femme qui virevolte, l’infirmière doit arriver à la maîtriser par une parole apaisante…pas facile. Ce sera chose faite lorsqu’elle lui dira qu’elle la croit. Il fallait que la soignante ait le moyen de déverrouiller sa colère. In fine elle a réussi. Cet exercice de simulation est interprété devant des étudiantes.
Autre cas : un patient pour qui tous les traitements sont désormais inefficaces, doit aller en soins palliatifs. Solution que sa femme rejette vigoureusement. Elle estime en effet que son mari est en train de recouvrir la santé ! Il faudra une immense patience à l’infirmière pour la convaincre alors que son époux est d’accord. La soignante, sous les yeux des étudiants,multiplie les tentatives. Succès à la fin dont les modalités ont été retenues par les futurs infirmiers et médecins.
Situation différente qui met aux prises un urgentiste et un anesthésiste. Le premier rentre d’intervention, épuisé. Le second a besoin d’urgence de celui-ci au bloc opératoire. L’urgentiste répond qu’il doit refaire son sac de mission et reprendre souffle. La tension monte car l’épisode est critique. Comment le surmonter ? Rétablir entre eux un minimum de compréhension. C’est long, compliqué… ils finissent par y parvenir. La scène est expressive et provoque une réflexion intéressante chez les étudiants.
Alexe Poukine montre combien de décryptage des cas problématiques est important. Il met en scène des débats, des échanges des analyses qu’effectue le duo soignant-apprenti soignant. Des comédiens viennent également à la rescousse. Leur rôle ? Insister sur la distance à observer confrontés à un malade car s’il faut faire tomber les barrières avec lui, il ne s’agit pas de fusionner dans sa souffrance !
Savoir poser les questions sans esquiver celles qui sont délicates, mais en même temps ne pas être intrusif. Être bienveillant en maîtrisant ses émotions. Ne jamais juger le patient. Les exercices de simulation sont là pour surmonter les difficultés éprouvées.
Michèle Acquaviva-Pache
• Françoise Vesperini, directrice adjoint de l’hôpital de Bastia ; Sophie Guillaume, sage-femme ; Cathy Giraldi, formatrice à lIFSI (Institut de formation aux soins infirmiers) ont participé au débat qui a suivi « Sauve qui peut », ainsi que des spectateurs…
En prologue à toutes nos vies on a pu découvrir un court-métrage, « Toutes nos vies » de Denis Parent. Ce film est un coup de projecteur sur une institution qui s’occupe de jeunes handicapés depuis cinquante ans. Les musiques sont de Patricia Pli et Pascal Arroyo. Un court d’une grande humanité.
ENTRETIEN AVEC CATHY GIRALDI, formatrice à l’IFSI.
Avant d’être formatrice à l’Institut de Formation paramédicale du centre hospitalier de Bastia CathyGeraldi a pratiqué pendant dix ans en cancérologie. Elle a précisément exercé comme infirmière d’annonce auprès des patients.
Avez-vous des équipements spécifiques pour pratiquer la simulation ? Comment procédez-vous ?
Nous disposons de plusieurs salles affectées à cet exercice. Dans l’une d’elles est installé un mannequin haute-fidélité que servent les scenarii construits. A notre disposition une autre salle, qui nous sert de régie où les formateurs peuvent faire évoluer l’histoire choisie en fonction de nos attentes pédagogiques. Les étudiants passent en groupes de trois en se rodant à l’abord de ceux qui seront leurs patients dans l’avenir. Cette séance dure trois heures au cours de laquelle ils participent à trois scénarii différents. Ensuite vient le débriefing dans une autre salle dédiée. Cette phase est la plus importante, parce que le formateur en revenant sur des moments clés de la simulation, crée des ancrages.
Dans quelle optique cette utilisation de la simulation ?
Notre but est de permettre à ceux qui deviendront des soignants, de développer leur réflexivité, les gestes et les postures indispensables. Notre objectif est de donner aux étudiants de l’expérience, de les entraîner au terrain et de leur éviter trop d’erreurs. La simulation doit encore faire le lien entre les cours théoriques et la pratique.
Que représente pour vous la simulation ?
Pour moi, c’est un outil puissant d’apprentissage… Mais rien ne vaut bien sûr l’expérience acquise sur le terrain.
Lors des séances vous employez divers scénarii. Varient-ils beaucoup ?
Ils dépendent de l’objectif pédagogique ou de la pathologie du patient que nous voulons aborder. On n’approche pas un infarctus du myocarde comme une détresse respiratoire. Nous recourons à une diversité de scenarii. Varier ses attitudes lorsqu’on est confronté à des situations qui peuvent être malheureuses, ça s’apprend !
Dans son documentaire Alexe Poukine fait appel à des comédiens pour simuler des situations. Vous aussi ?
Oui, pour l’approche de soins relationnels, on dispose d’une liste d’acteurs, qui font du théâtre amateur, mais qui ont également de la bouteille. A eux d’interpréter les patients. Ces comédiens sont membres d’associations, on les défraye au taux horaire de bénévoles. On les place dans le cadre de chambre le plus proche de la réalité. Avec eux et les étudiants on travaille donc sur les soins relationnels comme la négociation. Exemple : quand un patient refuse un traitement il faut que les étudiants sachent le convaincre dans son intérêt et celui des soignants. Ça aussi, ça s’apprend !
Simulation avec un mannequin perfectionné ou par l’entremise d’un acteur, en quoi cela vous aide-t-il véritablement
Grâce à ces moyens nous voulons que les futurs infirmiers acquièrent de la spontanéité dans leurs réponses et qu’ils fassent ressortir leurs émotions. Au quotidien ils risquent d’avoir une pression énorme qu’on doit les aider à surmonter. « Jamais la première fois sur le patient », c’est la sécurité et la qualité qui priment.
La simulation a-t-elle ses règles d’or ? Si oui, quelles sont-elles ?
Au début on établit un contrat entre formateurs et élèves. Nos règles sont la bienveillance, le respect, les erreurs sont permises, il ne doit pas y avoir de jugement de valeur et nous insistons sur la nécessité de la confidentialité. Ce contrat est validé à l’oral par celui qui deviendra un soignant et par les formateurs. De notre part il n’y aura pas d’évaluation lors de ces séances.
Quelles sont les situations les plus dures à affronter face à n malade ?
Les difficultés émanent de nombreux facteurs. Quand il s’agit d’un soignant il faut retenir son état émotionnel, ses valeurs, sa culture, son âge… Quand il s’agit d’un patient on doit veiller à sa pathologie, à son histoire de vie…
Quelles peuvent être les réactions des soignants et des malades à une annonce de cancer qui ne laisse place à aucun espoir ?
Les soignants quels que soient leur expérience ou l’âge, etc… peuvent ressentir du malaise. Quant aux patients ils peuvent être dans le déni, éprouver un choc si grand qu’ils s’écroulent en larmes ou s’évanouissent.
Lors du débat qui a suivi la projection du film, « Sauve qui peut » au Régent, vous avez souligné l’importance des salles de pauses. Pourquoi ?
En soignant les malades les infirmières ressentent fréquemment de fortes émotions qu’elles doivent contenir face aux patients. Or, ce genre d’émotions il faut les déposer en discutant avec leurs homologues afin de pouvoir lâcher prise. Les pause-café sont des occasions bénéfiques, si on refuse d’emporter ces émotions à la maison !
M.A-P
Crédits photos : << Sauve qui peut >>